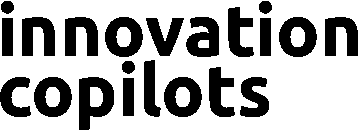A-t-on sauvé le soldat BPI ?
Ne sachant pas si cela allait être très productif, j’ai beaucoup hésité à parler des changements annoncés par la BPI :
Jusqu’à présent, nous avions une vision trop technologique de l’innovation, ce qui nous obligeait à tordre nos critères de financement pour soutenir certains projets prometteurs. Pour régler ce problème, nous avons donc pris le temps d’opérer un changement profond dans notre stratégie d’investissement – Paul-François Fournier, BPI
Si l’agitation brownienne de la Frenchtech autour des clochers de village ne peut conduire à rien, l’ouverture de la BPI à l’innovation non-technologique est peut-être, enfin, celle d’une bascule complète de notre économie.
L’enjeu est de savoir si cette bascule va s’opérer dans les trois ans à venir ou non.
Car si elle ne s’opère pas, ce sera une vraie raison de ne plus se préoccuper sérieusement de l’activité des pouvoirs publics en France, sur le sujet de l’innovation. Ce sera aussi par voie de conséquence une bonne raison d’oublier toute idée de leadership industriel à la française dans les dix ans à venir. Comme les mines de charbon et la sidérurgie, le sujet aura été abandonné à son obsolescence programmée.
Essayons de discuter ces quelques points.
Fluctuat nec mergitur
Avant de parler de la BPI, il nous faut parler de l’écosystème de dispositifs que la BPI finance et soutient.
Si vous avez été un créateur d’entreprise forcé d’être aux prises à cet écosystème public et para-public de l’innovation ces dix dernières années, vous devez déjà lever les yeux au ciel…
Sans même nous engager sur le terrain des compétences effectives de ces dispositifs, nous ne pouvons éviter de parler de leur représentation redondante, pléthorique et quasi-fractale.
L’origine de ce mille-feuille dont nous avons le secret, est en quelque sorte une réplication pure et simple de notre mille-feuille politique. Chaque échelon national, régional, départemental, intercommunal, communal souhaite revendiquer son implication (et son importance) dans l’un des rares terrains de jeu qui met tout le monde d’accord (l’innovation c’est bien, le terrorisme c’est mal). À cela s’ajoute notre besoin irrépressible des lieux « emblématiques » : les grounds zéro du rayonnement de notre importance. De fait, chacun y va de sa maison, de son hub, de son incubateur, de son lab et autre lieu dont le seul attrait semble être une machine à café autour de laquelle se retrouvent en milieu de matinée, quelques entrepreneurs égarés. Et ne me lancez pas sur la mode actuelle des accélérateurs, dont le seul vrai point commun est d’avoir réalisé que par manque de formation objective, la majorité des porteurs de projets français cèdent des parts de capital, comme des pom-pom girls sous acide.
À la fin de l’histoire, au lieu de créer des dispositifs simples, transverses, propices à une diffusion rapide des besoins et ressources, nous sommes affublés d’un maillage territorial de dispositifs qui s’asphyxient les uns les autres, en recherche de projets à héberger. Lesquels ? Tous, pourvu qu’ils viennent. Car, le point commun de toutes ces structures est le besoin de se nourrir d’entrepreneurs pour préserver leur existence et maintenir un semblant de crédibilité. Vous vous rappelez l’adage qui vous a fait réaliser quel était le modèle économique de Google ? Quand c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit. Ici, c’est pareil.
Je me rappelle de ma naïveté en 2007, quand je pensais que l’objectif prépondérant pour la direction d’un de ces dispositifs devait être de faire sortir le plus vite possible les startups de sa structure (c’est mon côté trop en avance de phase, je devais déjà penser en terme d’accélération). Alors que non, leur indicateur clef était le taux de remplissage. Et de fait, une « startup » qui avait déjà huit ans d’existence et qui plafonnait à deux associés et un stagiaire, se révélait « un bon client ».
Il serait édifiant de faire les comptes de ce que coûtent au final ces dispositifs si l’on était capable de faire une comptabilité analytique ramenée aux emplois, ou au chiffre d’affaires créé. Le toujours très pertinent Olivier Ezraty avait eu un début de discussion à ce sujet en 2012, mais au final personne ne veut vraiment savoir. Entre chirurgie orthopédique lourde et effet Placébo, la France a fait son choix.
Et dans cette mélasse, on finit par être surpris de découvrir des pépites d’équipes motivées, expérimentées, qui s’empoignent pour trouver des budgets. Cela en est même amusant, puisque souvent ces dispositifs sont les bons plans que certains entrepreneurs se refilent entre eux, telle une improbable marchandise de contrebande.
En conclusion de cela, comme beaucoup de serials entrepreneurs vous le dirons, mon conseil est assez stable concernant les dispositifs de l’innovation en France : évitez-les, ou au moins, ne commencez pas à vous inscrire dans trente-six d’entre eux pour aller chasser les enveloppes, les subventions et autres prêts d’honneur. Si vous partez dans cette logique, vous allez survivre sous perfusion, avant de vous rendre compte que vous en êtes devenus le produit et que vous n’avez pas avancé d’un pouce sur votre projet depuis trois ans.
Nous sommes une partie du problème
Si je vous livre en fin de compte un tableau bien noir des dispositifs de soutien à l’innovation, vous devez vous dire que nos rémunérations étant issues de budgets publics, nous sommes contributeurs de ce problème.
J’aimerais vous dire que non, mais ce ne serait pas complètement honnête.
Il est vrai qu’autour de cet écosystème globalement dysfonctionnel, un grand nombre de professionnels privés vivent. Certains en sont même la représentation la plus frappante, dans leur capacité à décrypter les méandres de la BPI, pour vous permettre d’obtenir des subventions publiques, dont ils vont capter un pourcentage. Un bien joli solipsisme.
En ce qui nous concerne, notre modèle économique est stable depuis plusieurs années : la moitié de notre temps de travail est engagé avec des grands groupes industriels. Ils génèrent la majorité de nos revenus. L’autre moitié de notre temps de travail concerne des startups et certains des dispositifs publics évoqués. Je n’en ai pas fait la comptabilité précise cette année, mais au final nous avons moins de 20% de notre chiffre qui d’affaire qui provient de budgets publics (y compris du FEDER, ou autre subsides européens). Cela n’est tout de même pas négligeable.
Sur ces 20%, il y en a très peu qui proviennent de startups mobilisant un budget public pour nous faire intervenir. Notez bien que ce n’est pas tant que nous n’en voulons pas, ou que nous refusons ces budgets (j’ai au moins cinq interventions dans ce cadre précis qui sont programmées dans les mois qui viennent). C’est qu’en dehors de circonstances particulières nous avons appris depuis 2007, que c’était de l’argent fichu en l’air et donc pour nous des missions très insatisfaisantes.
Pourquoi ? Parce que ces missions ne sont percutantes, que si elles se font dans le cadre d’un accompagnement global, avec un chargé de mission impliqué et compétent du côté du dispositif public.
Depuis le lancement de l’agence, nous avons dû nous éduquer par essais-erreurs avec notre part d’errements, avant de trouver au fil du temps quelques interlocuteurs solides avec qui collaborer sur certains territoires. A posteriori, toutes ces structures ont eu avec nous la même approche, dictée par une lucidité froide sur le peu de temps qu’il leur était dorénavant accordé avant que de se faire effacer de la carte nationale, et aussi, par une vraie envie de livrer aux startups un parcours d’accompagnement solide. Quand en 2008 une première structure nous a dit en substance « OK, à part fournir des locaux chauffés et du WiFi à un coût de m2 raisonnable, nous ne servons à rien », nous avons été surpris. À la dixième, c’est devenu une évidence.
Depuis notre travail c’est de plus en plus déplacé de l’accompagnement des startups, à celui des dispositifs en question. Et nous ne travaillons plus qu’avec un nombre limité d’entre eux (une demi-douzaine sur la France entière, quelques incubateurs, une pépinière et deux pôles) : ceux que nous connaissons et que nous pensons pouvoir aider à mieux aider les startups.
J’imagine que nous sommes aussi finalement, dans une forme de solipsisme.
Lux in tenebris
Si nous revenons maintenant à la BPI, dans la mesure où elle est la glue reliant tous ces dispositifs publics, il semblerait adéquat de lever les bras au ciel est de s’exclamer « mais que faaiiiiiit la BPI ? » .
De fait, nous pourrions imaginer qu’elle puisse être plus critique et directive dans la validation et le financement de ses interlocuteurs, voire qu’elle arrête de perfuser de l’argent dans des clusters de type « Tissus traditionnels provençaux et Technologies du macramé », ou qu’elle exige dans de grandes métropoles que les acteurs se centralisent ou disparaissent… Mais je ne suis pas certain que ce soit une mission qu’elle ait à assumer. Littéralement : je ne sais pas s’il y a quelqu’un dont la responsabilité est de dire à une Région et un Conseil Général “vous faites les mêmes choses mal, vous créez en plus de la confusion avec tous les guichets étroits que vous avez ouverts, vous arrêtez”.
Non, ce qui était franchement opposable à la BPI c’est son érotomanie culturelle pour la technologie :
Une bonne startup, est un startup qui produit du brevet, qui invente de la technologie, et si possible, si possible… qui soit issue d’un laboratoire de recherche internationalement reconnu !
Cette injonction immanente de tous les gouvernements depuis l’après-guerre provient de notre culture napoléonienne et de notre spécialité nationale : la formation des élites par les écoles d’ingénieurs et notre besoin consécutif de planifier, d’ordonnancer et de mettre au carré les choses.
Quel qu’ait été son acronyme (ANVAR, OSEO) par le passé, la BPI est une structure financière conçue comme trésorier payeur de l’écosystème de l’innovation hexagonale. Sa mission de service public est claire et parfaitement cohérente : prendre des risques financiers dans des activités stratégiques pour notre pays, quand ces risques seraient intolérables pour des acteurs privés.
Il y aurait beaucoup à dire là aussi sur le fait que la BPI doivent surcompenser le désinvestissement du secteur bancaire qui (est-ce encore une surprise pour quelqu’un) a choisi depuis longtemps de ne plus faire son métier (à la création de Merkapt, notre banque nous a concédé un prêt de 20K pour amorcer notre besoin en trésorerie, dont 50% provenaient d’OSEO qui garantissait par ailleurs 80% du risque – prêt qui ne nous a jamais servi et que nous avons diligemment remboursé, mais qui nous avait apporté un vrai confort psychologique à l’époque). Nous pourrions aussi parler de façon connexe du naufrage du CIR majoritairement capté par les grands groupes (banques, assurances), mais nous dériverions à n’en plus finir.
Pour revenir directement au sujet, plus de cinquante ans d’histoire se sont obstinés à nous montrer qu’un Concorde, un TGV, un Minitel ou un Rafale, ne faisaient pas plier par leur seule avance technologique les marchés internationaux. Pour ceux qui auraient des doutes, il suffirait de lire le dernier rapport de la commission qui recadre annuellement nos élus sur ce sujet. Le plus clair et pondéré a été à mon sens émis en 2009 par les très pointus Delphine MANCEAU et Pascal MORAND. Le rapport s’appelait déjà Pour une nouvelle vision de l’innovation.
Que n’avait’il été lu et écouté à l’époque !
Je pourrais vous en extraire des citations cuisantes toute la journée, mais contentons-nous du très neutre et très modeste :
Selon l’OCDE, plus de la moitié des innovations n’intègrent aucune dimension technologique et relèvent de l’usage, des business models ou des processus organisationnels.
Alors bien entendu, quand en fin de course la Cour des Comptes relève les compteurs, ce n’est pas joli à voir. Attendons stoïquement fin 2015 pour avoir les premiers retours saignants sur les SATT… au moins en ce qui les concerne le problème aura été centralisé.
Quand le vénérable Schumpeter distinguait innovation et invention, il s’attendait certainement à énoncer un truisme :
L’invention signifie la conception d’une nouveauté. Alors que l’innovation se définit par l’introduction d’une invention dans l’environnement social. Le marché est une forme spécifique de l’organisation sociale.
Ce n’était pas le cas.
Ægroto dum anima est, spes est
Nous en arrivons maintenant à février 2015 et la BPI nous annonce un virage à 180° : elle va financer l’innovation non-technologique.
C’est une révolution copernicienne.
Quand nombre de startups cherchaient à monter des projets collaboratifs et des partenariats avec des laboratoires du CNRS pour prétendre à des aides qu’elles n’auraient jamais dû toucher , aujourd’hui elles devraient pouvoir aller taper directement à la porte de la BPI.
Glissons sur le storytelling de la BPI, qui vraiment, vraiment avait voulu aider Blablacar à l’époque (c’est peut être même vrai qui sait ?), passons sur le fait que ce sera une évolution iso-budget (c’est probablement même une bonne chose), ne regardons pas de trop près le référentiel adopté qui est simpliste (comment une innovation « marketing » n’est pas une innovation de modèle d’affaire ?) et surtout ne ricanons pas sur le fait que dix ans après la bataille (et des dizaines de voyages dans la Silicon Valley), la France adopte les préconisations de l’OCDE sur l’innovation :
Les raisons d’être optimistes…
1. Certes, le cadre de lecture proposé est simpliste, mais…
Il y a tellement de retard à rattraper, qu’un message simplifié devrait permettre une propagation à tous les niveaux du mille-feuille.
Le court document de 66 pages, clair et aéré qui sert de support de communication joue de ce point de vue un rôle efficace. Et les fiches de lecture associées (qui je crois n’ont pas été diffusées publiquement) ajouteront un peu plus de contenu en illustrant des cas « exotiques » d’innovation.
2. Nous avons une chance de sortir des effets de mode sur l’innovation.
Même si dans le livret on ne s’épargne pas un couplet sur l’innovation ouverte, nous avons une chance à saisir pour briser les effets de mode qui tous les trois ans embrasent l’écosystème national. Non, l’innovation ouverte n’est pas une martingale gagnante, pas plus que le design, que le lean startup ou l’innovation frugale. Toutes ces méthodologies sont des outils. Comme un tourne-vis ne va pas être efficace pour enfoncer un clou, ces outils sont stupidement contre-productifs si on les met en oeuvre à l’emporte-pièce.
Parler au global d’innovation non-technologique, devrait nous permettre enfin de prendre de la hauteur. S’il faut se forcer à distinguer l’innovation « marketing » de l’innovation de « service », ce n’est pas un prix à payer très élevé. Pourvu que l’on apprend à appliquer sélectivement telle ou telle approche, ou même (soyons fou) à les coordonner entre elles quand cela est pertinent de le faire.
3. Nous pourrions arrêter de nous focaliser sur la recherche.
Depuis le temps que l’on en parle, il devrait être possible de nous reconcentrer sur la transformation du marché : la startup résout elle un problème important ? Son marché potentiel a-t-il compris ce dont il s’agit ? Est-elle équipée en terme de compétences, de profils et de ressources pour aller sur le marché ?
En 2015, nous en sommes encore à être sidérés quand des développeurs se mettent à parler des clients.
C’est de notre faute. Les projets de laboratoire sont tellement soutenus, que bien peu réalisent qu’ils vont devoir facturer quelque chose à quelqu’un un jour. Oh, bien sûr ils comprennent parfaitement la logique. Ils semblent juste ne pas arriver à croire qu’elle finira par s’appliquer à eux-mêmes.
4. Le mille-feuille peut être pris en sandwich
Désolé de l’image que cela peut évoquer, mais en clair, si la BPI active sa nouvelle vision assez vite, quelques opérateurs du mille-feuille déjà en avance sur l’innovation non-technologique vont pouvoir sortir du bois et expliquer ce qu’ils font au grand jour.
C’est un point clef.
Une telle transformation ne peut s’opérer que par des « quick wins » de structures déjà opérationnelles sur le sujet et qui pourront partager leurs pratiques. Il y en a très peu en France.
Je sais bien que depuis dix jours tous les incubateurs et toutes les pépinières auront compris qu’il faudra bêler avec le reste du troupeau pour faire passer leurs dossiers. Mais quelques-uns soutiennent déjà l’innovation non-technologique depuis plusieurs années et ont de quoi le démontrer. Je ne vais certes pas faire leur « outing » mais j’espère qu’ils sortiront du bois.
Les sujets d’inquiétude
1. Qu’est-ce qui est réellement fait demain ?
Pour l’instant, l’effet d’annonce est là. Demain, que font les chargés de mission de la BPI ?
Confrontés à un appel d’air qui sera probablement énorme, qui les aura formés ? Quels sont les référents internes ? Face à la limitation des budgets que la BPI peut libérer, quelle part sera ventilée sur le non-technologique ? Qui au final arbitrera en disant, que non mettre, les réservations de votre restaurant sur Facebook, ce n’est pas de l’innovation de service, ni de marketing ?
Soyons technique trente secondes sur cette dernière question : une définition de l’intensité de l’innovation est donnée aux chargés de mission :

Celle-ci est bloquée sur deux positions : innovation incrémentale ou radicale. Personne ne peut croire que cela est suffisant. Nous touchons là au coeur du métier du financement de l’innovation : comprendre et définir le niveau de risque / d’innovation. Sans autre grille de lecture à granularité fine, appuyée sur un référentiel objectif, on fait quoi ?
On ne peut pas imaginer dire à un banquier « Bon, voilà Robert, ce mois-ci pour les prêts à la consommation tu peux soit faire un peu, soit beaucoup. Mais pas plus hein ? ». Ce n’est pas sérieux.
Sur ce qui peut sembler être un détail, nous allons vite juger si la BPI est dans une posture de communication, ou dans une vraie volonté de changer l’écosystème.
2. Allons-nous enfin mobiliser les écoles et les universités ?
Quand le modèle américain nous fait rêver, nous ne voulons pas voir que son efficacité tient largement au fait que sa recherche publique est devenue privée depuis bien longtemps. Ayant été salarié du CEA j’ai du mal à parfaitement adhérer à ce principe. Mais je lui reconnais une vertu : la recherche étant déjà pour l’essentiel dans une logique de débouchés marchés, un chercheur de Stanford n’a aucune distance culturelle à franchir pour créer une startup. Sans parler du fait qu’il sait qu’il ne pourra pas pantoufler jusqu’à la retraite dans son labo…
Si nous changeons nos clefs de lecture sur l’innovation, quand met-on l’amont de l’écosystème dans cette logique ? Explique-t-on aux universités que l’on peut faire certes de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée sur des budgets privés ? Quelqu’un a prévenu le ministère de l’Éducation nationale ? On en parle aussi aux écoles de management et de design ?
Commençons-nous enfin à stresser de voir des campus de 2.000 étudiants, toutes disciplines confondus, ne pas arriver à produire 10 startups par an ?
3. On replonge dans la zone de confort ?
L’enthousiasme que m’a provoqué l’annonce de la BPI a été douché quelques jours après quand j’ai vu qu’elle allait aussi créer un « Hub ». À lire ce dont il s’agit et au vu des outils mis en oeuvre, nous restons dans les vieilles recettes où les startups vont être briefés à coup de juridique et financier. La grande idée c’est de se remettre à cracher du business plan ?
Surtout que dans les critères de sélection des projets accompagnés, le critère c’est qu’ils aient déjà fait une première levée de fonds ! À quoi bon encore les abrutir de conseils sur le haut et le bas de bilan ?
Quand dans son nouvel élan la BPI analyse Blablacar comme de l’innovation de Produit, service / Marketing, commerce / Modèle d’affaire (je me mords la langue…), la conclusion logique est que les risques et besoins du projet sont triples :
- Ne pas parvenir à la masse critique d’utilisateurs ou échouer à constituer une communauté.
- Ne pas parvenir à monétiser le service (protestations de la communauté des premiers utilisateurs, désertion massive vers une autre plateforme…).
- Échouer dans la pénétration d’autres marchés.
Alors, on fait quoi avec ça au Hub ? Parce que ces trois points sont un seul problème. Et les termes techniques associés sont « business asymétrique », « masse critique », « effet de plateforme » et « point de bascule ». Il y a des logiques de travail claires sur ces sujets et la dernière fois que j’ai vérifié, Excel n’allait pas beaucoup aider à les résoudre.
4. Qui restera à la manoeuvre ?
À n’en pas douter, bon nombre des acteurs publics du mille-feuille doivent être bien surpris du repositionnement de la BPI. Que feront-ils maintenant dans ce jeu ?
Si nous sommes dans l’effet d’annonce pur, rien ne bouge est c’est une catastrophe. L’Europe a déjà changé de position sur le sujet il y a plus de dix ans, nous n’aurons pas encore dix ans pour nous mettre en action.
Si la BPI avance réellement avec son repositionnement, qui va suivre ? Plus précisément qui va survivre ? Car si je lis bien le marché aujourd’hui, la BPI n’aurait besoin que de se reposer sur deux acteurs :
- Les SATT d’une part pour poursuivre les croisades technologiques sous les hurlements de la Cour des Comptes ;
- Les accélérateurs privés, d’autre part, en mode innovation d’usage, pour capter le dessus du panier des projets régionaux et leur amener une masse critique.
Et cette bipolarisation caricaturale serait une autre catastrophe.
Dans tous les cas, ne nous ne faisons pas d’illusion, tout comme le crédit impôt recherche a été largement siphonné par les grands groupes, ce changement de situation va créer des effets d’aubaines. Et certains sont déjà sans nul doute à la manoeuvre… Alors, oui notre écosystème est bordélique, inconsistant et peu efficace (The Family, le qualifiait à juste titre de « toxique »), mais doit-on pour autant le réduire à une polarisation extrême ? Un pôle stable dans son inefficacité et l’autre destiné à disparaître quand l’effet d’aubaine n’est plus là dans 3 ans ?
Quand aurons-nous fini par comprendre que 300K mis dans du développement technologique peuvent être beaucoup moins productifs que 100K de pur développement du business. Et si ces 100K sont des bons d’achat offerts par Google, dînons-nous avec eux ? Et la fourchette sera-t-elle assez longue ?
Alors a-t-on sauvé le soldat BPI ? Je ne sais pas, mais les mois qui viennent vont être intéressants.
En ce qui concerne notre agence, nous ne sommes évidemment qu’un micro-acteur avec bien peu de poids dans tout ce que j’évoque. Mais comme n’importe quelle entreprise, nous avons besoin de nous mettre en contact avec notre marché là où il est. Et notre marché est celui de l’innovation, celui ou ceux qui modestement ou radicalement changent le marché sont présents. Si cela devient à la mode aujourd’hui tant mieux. Si on se met à réellement le faire non pas dans des poches de résistance, mais à l’échelle nationale et de façon coordonnée, c’est encore mieux.
En attendant, je regarde mon calendrier du mois prochain et je suis en Chine.